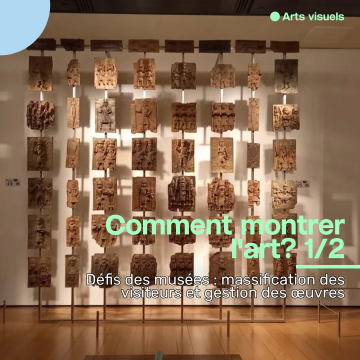12 juin. 2024L’art au Musée 2/2

Le Musée en crise ?
C’est pour parer à cette situation défavorable que dès la deuxième moitié du dix-neuvième siècle des initiatives diverses s’étaient développées afin de donner une visibilité publique à l’art en train de se faire, parmi lesquelles, en France le Salon des Refusés, ou, en Allemagne et Autriche, les « Künstlervereine » défendant l’art avancé, et, dans tous les pays d’Europe, la création de véritables galeries d’art par les marchands d’art. Le premier musée consacré spécifiquement à l’art vivant fut le Museum Folkwang fondé en 1902 à Hagen (et transféré en 1922 à Essen) par l’industriel Karl Ernst Osthaus. Centré sur l’art moderne et contemporain de l’époque (notamment Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin et Henri Matisse), avec une ouverture au design et aux arts non-européens, il eut une influence énorme sur le développement des musées d’art moderne (ou d’art contemporain). Il fut ainsi une des sources d’inspiration de la création du MoMA à New-York en 1929, qui à son tour devint le modèle qu’émulèrent par la suite la plupart des musées consacrés à l’art moderne ou contemporain. Si le musée « universel » tel que l’avait conçu le dix-neuvième siècle avait cru pouvoir dicter l’avenir de l’art en forçant les artistes à imiter les maîtres du passé, les musées d’art modernes et contemporains furent tous fondés sur la prémisse inverse : ce n’était pas à l’art de s’adapter au musée mais au musée de s’adapter à l’art, ou plutôt d’être à l’écoute de l’art.


C’est à peu près à la même époque que la prétention universaliste des musées créés au dix-neuvième siècle commença à être remise en cause. Les artefacts artistiques des « primitifs » avaient été collectés en général par les muséums d’histoire naturelle : on y voyait de simples témoignages de la survivance d’un supposé passé archaïque et non pas des œuvres d’art. Cette position devint intenable dès lors que les artistes modernistes du début du siècle chantèrent la force d’inspiration des masques africains pour leur œuvres, et dès lors que, au même moment, une nouvelle génération d’anthropologues (parmi lesquels Franz Boas, un des inspirateurs de l’anthropologie culturelle) montrèrent que cognitivement tout autant que socialement et culturellement, les sociétés sans écriture n’étaient pas plus « primitives » que les sociétés industrielles, mais simplement différentes. Par conséquent les artefacts en question finirent par quitter les musées d’histoire naturelle pour des musées nouvellement créés pour eux (par exemple en France le Musée de l’Homme, créé en 1937), ou, plus rarement, intégrèrent les collections des musées « universels » créés au dix-neuvième siècle.
On critique parfois cette évolution en y voyant une esthétisation abusive des artefacts qui dans leur contexte originaire avaient une fonction rituelle, mais cette accusation pourrait être dirigée avec autant de pertinence (ou de manque de pertinence) contre le transfert des sculptures religieuses du Moyen Age dans les musées consacrés à l’art européen.
La question de l’esthétisation doit être distinguée d’une autre crise, d’ordre éthique et juridique celle-là, et concernant elle aussi les musées d’« arts premiers ». Encore très actuelle, elle comporte deux aspects : d’une part la question de la restitution des artefacts volés ou dérobés sous la contrainte aux peuples et communautés « indigènes » lors des entreprises de colonisation ; de l’autre, le problème de la profanation qu’implique la présence dans des contextes d’exhibition muséale d’artefacts qui sont (aujourd’hui encore) sacrés dans leur société d’origine (notamment tous les objets jouant un rôle dans les rites funéraires).
Enfin, les musées d’art, quels qu’ils soient, sont actuellement tous face à la menace d’une autre crise, qui risque de nuire fortement à la fonction pour laquelle ils avaient pourtant été créés. Le musée d’art était censé être un lieu invitant à une expérience pensive et contemplative des grandes œuvres, susceptibles non seulement d’enrichir les connaissances culturelles des spectateurs, mais, plus fondamentalement, de transformer ces spectateurs (ce n’est pas pour rien qu’au dix-neuvième siècle les musées aspiraient au statut de cathédrales du présent). Mais une telle expérience transformatrice est liée à des conditions : elle exige du regardeur une grande patience du regard et de l’intellect. Or, dans les sociétés actuelles ces conditions sont rarement réunies. Une enquête réalisée en 2017 au Art Intitute of Chicago révéla qu’en moyenne un spectateur n’accorde que 28 secondes d’attention visuelle à chaque œuvre (Smith, L. F., Smith, J. K., & Tinio, P. P., « Time spent viewing art and reading labels », Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2017, Vol. 11, N° 1). Le constat rejoignait celui fait en 2001 lors d’une étude menée au MET de New York. Donc, les actions des musées en faveur de la promotion du « Slow art » entreprises depuis de nombreuses années n’ont rien changé aux habitudes des spectateurs. Il y a pire : d’autres études ont montré que beaucoup de spectateurs passent plus de temps dans d'autres espaces du musée – la libraire, le café, le jardin s’il y en a un - que devant les œuvres exposées. En caricaturant on pourrait dire que dans les sociétés actuelles « aller au musée » exprime l’attente d’une expérience plaisante dans laquelle contempler les œuvres n’est qu’un ingrédient parmi d’autres.


Bien sûr, la taille des grands musées nationaux et le nombre souvent vertigineux d’œuvres qui y sont exposées, de même que la démesure de nombreuses « grandes » expositions, ne favorisent pas un recentrage sur l’expérience approfondie des œuvres. Mais la cause profonde est liée à l’évolution de nos sociétés. On a noté depuis longtemps que dans les sociétés contemporaines la saturation de l’attention (visuelle et autre) des individus par des stimuli de plus en plus multiples et de plus en plus intenses, qui se font la concurrence pour capter l’attention, a produit une véritable crise des capacités d’attention individuelle : nous sommes de moins en moins capables de nous focaliser suffisamment longtemps sur un même objet pour pouvoir en faire réellement l’expérience. La crise du regard muséal n’est qu’une des conséquences de cette crise générale de l’attention. La numérisation de la société, en exacerbant la course à la quantité d’informations disponibles et à la rapidité de leur traitement, augmente encore cette crise. Dans le domaine de l’art, la multiplication des musées virtuels et la numérisation systématique des œuvres d’art, renforcent ainsi le biais attentionnel en faveur de la première impression (le « gist » selon le terme utilisé par les psychologues) : les œuvres picturales sont réduites à des images dont il s’agit d’extraire le plus économiquement et le plus rapidement possible le plus d’informations possibles. Cette dématérialisation de la peinture, du dessin ou de la sculpture les dépouille de leur agentivité, qui est indissociable du fait qu’ils ont été créés comme des objets matériellement incarnés destinés à être rencontrés dans l’espace réel par des spectateurs corporellement incarnés.
Pourtant, rien ne condamne le musée à suivre cette pente. Au contraire, si nous en usions de manière plus réfléchie, si on nous apprenait la patience du regard, le musée d’art pourrait devenir un des lieux de résistance à cette accélération généralisée de l’attention. En effet, les œuvres d’art favorisent de manière naturelle l’apprentissage du regard lent et de l’attention pensive qui font partie du propre des humains depuis les temps préhistoriques et que nous risquons de perdre dans notre course généralisée à l’efficacité.
Les plus populaires
- 26 juin. 2024
- 20 juil. 2023
- 07 aoû. 2024
- 18 juil. 2024
ARTICLES
Articles
14 aoû. 2024Comment montrer l’art? 2/2
Articles
13 aoû. 2024Comment montrer l’art? 1/2
Videos
09 aoû. 2024