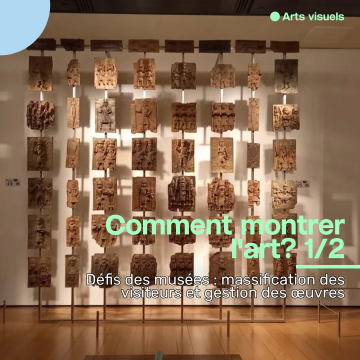17 mar. 2022Le fabuleux destin de Christine Muller

Émergence
Auteure, metteure en scène, comédienne, et tutti quanti, le nom de Christine Muller résonne de plus en plus fort au pays, et c’est bien normal au vu de son parcours exemplaire du côté académique comme à la scène. Après avoir passé plusieurs années sur les bancs de la fac, entre Paris, Hong-Kong et Lisbonne, en parallèle d’une formation au jeu au Théâtre des Quartiers d’Ivry à Paris, la jeune théâtreuse veut dorénavant mettre le focus sur son théâtre et s’y exécuter au texte, comme au jeu et à porter tout cela au plateau. Nourrie au fil des années, d’abord par ses marraines artistiques qu’ont été Marja-Leena Junker et Myriam Muller, sa passion pour le théâtre elle ne peut néanmoins pas la définir comme une prédestination.
Et pourtant, si Christine Muller ne trouve pas de liens directs entre sa direction vers les arts vivants et l’influence familiale, au détour d’une longue conversation, là voilà mentionner Clothilde Muller-Libeski, cinéaste avant-gardiste dont le travail est logé au Centre national de l’audiovisuel de Dudelange (CNA), une femme qui n’est autre que son arrière-grand-mère. Comme quoi, il n’y a pas de hasard, mais bien des « rendez-vous », comme disait Éluard. Et la luxembourgeoise a su saisir le coche, pour se retrouver aujourd’hui à rêver grand, haut et fort, et pour ce faire, monter sa propre compagnie théâtrale, le Libeski Kollektiv. Il n’y a pas de hasard, on vous dit. Ainsi, Muller se fraye sa propre destinée au pays de ses aïeuls, en France, et sûrement bientôt dans le monde, au vu des innombrables rencontres qu’elle a fait ces derniers temps. Elle nous raconte…

© Luc Muller
Brièvement, pouvez-vous nous résumer votre parcours et la naissance de votre passion pour les arts de la scène ?
Je suis luxembourgeoise. J’ai toujours vécu ici, au même endroit. Ma mère est italienne et mon père est belgo-luxembourgeois. Je n’ai jamais eu l’impression que dans ma famille quelque chose m’a poussé à aller vers le théâtre. Mon père a fait les Beaux-Arts de Liège et on allait donc visiter beaucoup de musées. Très tôt j’ai baigné dans l’histoire de l’art mais je connaissais très mal le théâtre. Autour de mes 15 ans, ma meilleure amie Alizée voulait entrer au conservatoire et m’a demandé de lui tenir la réplique. Je ne savais même pas que ça existait. Je me suis dit pourquoi pas tenter moi aussi le concours d’entrée, et on a toutes les deux été prises. J’ai atterri dans la classe de Myriam Muller. J’étais l’une des plus jeunes. Lors du premier cours, Myriam nous a demandé quelle pièce de théâtre on avait vu, ça m’a beaucoup gêné car je n’avais pas de souvenir d’avoir vu une pièce. Le théâtre n’était pas présent dans ma vie auparavant. Et dans un sens, ça me plait que ce soit quelque chose qui soit venu de moi. Je n’ai jamais réellement su ce que je voulais faire quand j’étais plus jeune… Je savais juste que je voulais faire des choses complètement folles, c’est la direction que je suis aujourd’hui.
Myriam Muller vous conseille à Marja-Leena Junker. Cette dernière vous propose un rôle dans Les Femmes Savantes créé en 2011. Vos premiers pas à la scène…
J’avais à peine 17 ans sur les Femmes Savantes, et j’ai ensuite enchainé plusieurs pièces sous la direction de Marja-Leena Junker ou Myriam Muller. Ça m’est un peu tombé dessus. Grâce à Myriam et à Marja-Leena, des femmes metteures-en-scène luxembourgeoises, les mamans artistiques de la plupart des comédien*nes de ma génération. Après avoir obtenu mon bac, je suis allé étudier la linguistique à Paris, pour ne quasiment jamais aller en cours. À la même période je jouais au Luxembourg dans Mille Francs de Récompense. J’ai toujours eu un rapport aux études un peu étrange. J’avais envie de me former académiquement, aller à la fac. Au lycée, j’étais toujours première de classe, on me disait « toi, tu vas réussir, tu es brillante ». Ça m’est resté quelque part, et de ces encouragements, je suis allé à l’université. Même si avec le recul ça n’avait pas de sens de prendre cette décision, j’avais envie de le faire. Et en même temps, durant mes études, je me suis toujours accrochée au théâtre, comme une forme de « schizophrénie ».

© Bohumil Kostohryz
Ainsi, vous cumulez un solide bagage universitaire autour du droit et de la gestion des arts et de la culture. Plusieurs clinquants stages viendront s’ajouter à ce parcours académique exemplaire, à l'Ambassade du Luxembourg à Rome, dans un cabinet d'avocats pénal international à Paris et au Muséum national d'histoire naturelle à Luxembourg. Quelles étaient vos ambitions dans la poursuite de ce cursus ?
La fac m’a faite telle que je suis aujourd’hui. J’aurais été frustrée de ne pas faire d’études, d’acquérir des connaissances théoriques. Ça fait partie de moi, j’ai envie de connaître plein de choses, d’être érudite. À l’époque, je pensais que ça passait par la fac. Je me suis toujours débrouillée pour faire des choses à côté, et j’avais pas mal de mépris pour les gens qui allaient tous les jours à la fac. J’étais un peu arrogante. Mon but était de faire du droit de la guerre, du droit international public, avec des cours de diplomatie… Ça m’intriguait et ce sont des thématiques qui se sont glissées dans ma pratique artistique actuelle. Si je ne l’utilise pas encore dans mon écriture, j’aimerais un jour écrire une grande pièce autour de tout ça. Quoi qu’il en soit ça a forcément influencé mon écriture, et mine de rien pendant mes études, il fallait que j’écrive énormément. Je ne sais pas si je serais allé vers l’écriture si je n’avais pas été à l’université. Je n’ai donc aucuns regrets.
En même temps, vous n’avez jamais cessé de vous former en tant que comédienne dans des formations d’art dramatique au Théâtre des Quartiers d’Ivry à Paris et au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Le liant entre cette formation académique et pratique, ça a été l’écriture finalement ?
Quand je suis revenue de mon échange international à Hong Kong, j’avais envie d’aller à l’étranger, faire complètement autre chose, et je me suis lancé dans un Master en Cultural Studies à Lisbonne. C’était une expérience particulière parce que je ne parlais pas la langue et je me suis vraiment rendu compte que je n’avais pas envie d’être dans un pays dont je ne parle pas la langue. Durant cette année, je me suis beaucoup questionnée sur ce que je voulais faire dans ma vie. Un questionnement qui m’a amené vers l’écriture. Quand j’ai vu l’appel à projets du TalentLAB, je me suis dit qu’il fallait que je postule. J’ai été sélectionnée, et j’ai commencé à écrire pour créer là-bas cette petite forme un peu étrange, baptisée par la suite Cocons. L’écriture m’est apparue comme une évidence grâce au TalentLAB qui m’a permis de bénéficier d’une plateforme de recherche et de travail autour de mon travail dramaturgique.

© Bohumil Kostohryz
En juin 2017 donc, au sein du TalentLAB, vous montez Cocons. Dans cette maquette vous faites jaillir le traumatisme d’une mère, dans une forme entre solo chorégraphique et monologue théâtral, le premier formulé par la danseuse Piera Jovic, le second que vous portez à la scène en qualité d’auteure et d’actrice, accompagnée par votre sœur Céline. C’était important pour vous de passer par l’intime pour intégrer l’émergence du spectacle vivant luxembourgeois ?
Cette question est beaucoup revenue. Je vais résumer… En réalité j’avais envie de travailler sur un thème de la psychologie, avec ma sœur Céline Muller qui est étudiante en psychologie. De nos discussions, j’ai été très vite intriguée par le sujet des « non-dits ». Comme pour chaque porteur de projet du TalentLAB, j’avais une marraine en la personne de Julie Berès, et elle était assez intrusive. Elle est venue lors de notre première semaine de discussion et elle nous a fait rentrer dans une sorte de moule, autour d’idées très précises. On a trouvé intéressant de travailler sur le dispositif du non-dit, c’est-à-dire utiliser le « non-dit » directement dans le dispositif, pour amener le spectateur à se questionner sur la véracité de ce qui se dit en scène. J’avais plein de sujets en tête, je voulais que ce soit un non-dit familial, un mort-né dans la famille, un père qui est en prison, un viol, sans qu’on l’entende forcément… Et la question centrale pour la salle était de se demander « est-ce vraiment arrivé ? ». Ça a fonctionné à la force du dispositif qu’on avait choisi. Et oui, il y avait un fort lien intime, dans le sens où la question des violences faites aux femmes était très présente, même si on n’est pas allé puiser, comme on pouvait le penser dans la pièce, dans notre propre histoire familiale.
C’est un sacré pari que d’aller dans ce sens au TalentLAB qui est une plate-forme très douloureuse physiquement et intérieurement…
Ça nous a beaucoup aidé de discuter avec Julie Berès, parce que c’est un processus qu’elle maîtrise très bien pour avoir travaillé avec Milo Rau qui lui-même travaille dans ce sens. À l’amorce de la forme chaque parrain et marraine présentent la performance qui va suivre et à la fin du discours de Julie, je suis venue l’interrompre pour expliquer que je voulais parler à ma mère, en m’adressant à une femme au hasard dans le public. Même Tom Leick, directeur des Théâtres de la Ville de Luxembourg, se demandait ce que je faisais, et a dû me prendre pour une totale control freak… Cette performance allait dans ce sens, inspirée par cette façon de créer illusion du réel, et c’était très intéressant de s’approprier ce processus même si évidemment à double tranchant. C’est une forme unique, un pari, que tu ne peux faire qu’une fois, et ça correspondait bien au format que propose le TalentLAB.

© Bohumil Kostohryz
Ainsi, quelques années plus tard, vous êtes invitée à participer au 5 ans du TalentLAB, parmi plusieurs autres porteurs de projets des années précédentes. Dans ce cadre, en septembre 2020, vous mettez en scène, en collaboration avec Aude-Laurence Biver et Laure Roldàn, La rue des Fleurs n’existe pas au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Comment avez-vous vécu cette « incartade » en tant que metteure en scène ?
On avait le choix entre trois quartiers. J’ai tout de suite voulu me diriger vers le Pfaffenthal que je connais bien grâce à la maison Canopée. Les marginalisés, les forains et certains immigrés vivaient là-bas dans le temps. C’est un quartier intriguant. Cette bulle en pleine ville m’intéressait beaucoup de par sa mixité sociale qui fait aussi partie de moi, mes parents venant de deux catégories sociales très différentes. Cette rencontre entre des personnes qui n’ont pas du tout la même histoire est passionnante. Je connaissais Laure Roldan pour avoir joué avec elle dans le Misanthrope il y a plusieurs années, et j’ai découvert Aude-Laurence Biver sur ce projet. C’était super de travailler avec elles. On a commencé par se réunir dans un café tenu par Yasmine, une femme de ma connaissance qu’on a fini par convaincre de jouer dans la pièce. Notre travail au début c’était d’aller dans un bar et de papoter avec les gens, donc ce n’était pas trop mal pour se rencontrer artistiquement et humainement… Sous le conseil d’Anthony Heidweiller qui dirigeait ce projet, on a récolté de nombreux témoignages pendant plusieurs mois et en fin de compte, on voulait travailler avec trois femmes du quartier qui se voyaient quotidiennement dans ce bar, pour les mettre en scène, et faire entendre leur histoire.
Comment en tant que metteure en scène, on en arrive à convaincre le/la quidam à monter sur scène, braver cette terreur de la scène qui existe même chez les comédiens professionnels ?
Il ne s’agissait pas de leur dire « c’est génial, vous allez découvrir les coulisses du Grand Théâtre » ou ce genre de choses… Il s’agissait de les remercier de la chance qu’elles nous offraient de venir sur scène témoigner et raconter leur vie. C’était du stress pour elles comme pour nous parce que ça a été très difficile de les convaincre. Je pense qu’il y a eu cette force chez elles de se dire « je peux jouer, je suis une comédienne née ». Et en même temps c’est un exercice extrêmement difficile que d’aller sur scène, nous devions les protéger, leur parler de notre conception de cette forme théâtrale, faite d’interviews, de bruits de la ville, de textes qu’on a écrit… Et elles, sans texte, qui improvisent pour parler de leur propre vie… C’était magique.

© Bohumil Kostohryz
Et donc sur cette création vous rencontrez Aude-Laurence Biver, et en ce début d’année, vous l’assistez sur la création de sa pièce Fracassés de Kae Tempest. Que vous a apporté cette expérience accompagnée d’une des metteures en scène montantes du pays ?
Ce qui est super chez Aude-Laurence c’est qu’elle a un rapport très horizontal à la création. Tout se fait en collectif donc je me suis vraiment sentie intégrée à ce qu’elle faisait. On a beaucoup discuté, lu, et ça a été très enrichissant même si ce n’était pas la meilleure période pour créer avec la résurgence de la Covid. On était quand même assez anxieux par rapport à la situation, mais on y a échappé, même si Aude-Laurence a dû s’absenter un temps, à dix jours de l’entrée au plateau. Elle m’a fait suffisamment confiance pour que je puisse diriger les acteurs sans changer son univers, sans dénaturer ce qu’elle avait fait, en concertation avec elle à distance. J’ai été heureuse de rentrer pleinement dans son univers, et ça a été très formateur.
Il y a chez vous l’envie de faire du théâtre à tous les postes, en tant que comédienne, metteure en scène et auteure. Alors, dans ce sens, entre le 15 juin et le 15 juillet 2021, vous avez été sélectionnée pour occuper la résidence de recherche et de création à l’Academia Belgica de Rome. Quel était l’objet de cette résidence d'un mois au cœur du milieu romain et du réseau international d’académies et d’instituts de recherche auquel l’Academia Belgica appartient ?
Pour dire vrai, j’ai de la famille à Rome, donc je connais bien cette ville. Ça sonne un peu nombriliste de dire que je veux faire quelque chose qui me concerne mais l’Italie j’en entends parler depuis toujours. La culture italienne dans les familles immigrées – dont fait partie la sienne, ndlr – est très présente, on en parle beaucoup. Pour ma première pièce, je voulais traiter un sujet sur l’Italie avec toujours ce côté politique, bien que je n’écrive pas un théâtre politique, mais plutôt, je lie la politique à mon écriture. Je voulais parler des révoltes, à tous les niveaux, que ce soit dans la sphère intime comme dans Cocons, où une jeune femme explose, ou que ce soit au niveau politique, une révolte contre l’État. J’ai commencé à m’intéresser aux Brigades Rouges dont j’avais entendu parler sans comprendre ce que c’était. De là, j’ai voulu écrire autour de ça, partant du prisme des femmes. Dans ce texte, je parle donc des femmes dans les brigades rouges, et de leurs expériences assez particulières.

© Bohumil Kostohryz
Dans votre projet de récit théâtral semi-fictif Du rêve à la révolte : Nous répondrons désormais par les armes, vous abordez donc la figure de « la » terroriste, dans une recherche autour de la révolte et du militantisme italien. Pouvez-vous nous expliquer où vous ont amené vos derniers mois de recherches, et où en est ce projet aujourd’hui ?
À Rome, je me suis rendu compte que j’avais envie de commencer par le commencement. J’ai rencontré des personnes qui ont été actives pendant la période de l’enlèvement du politicien Aldo Moro. Se sont d’ex-terroristes, des personnes qui ont été condamnées pour des attentats commis pour détourner l’attention de Rome, et que j’ai pu rencontrer car ils sont aujourd’hui en semi-liberté. Concrètement, cette résidence a été un moment d’écriture et de recherche. J’ai pu faire beaucoup d’interviews avec des féministes ou des écologistes qui revendiquent par la violence, mais aussi des membres de CasaPound Italia, des néo-fascistes assez particuliers. Aujourd’hui, j’ai terminé une seconde version du texte, et bientôt je pourrais faire lire la pièce. Je ne cherche pas encore de soutien clairement. Je veux finir la pièce avant, et après la faire lire pour imaginer des suites. Je travaille step by step, ça me vient un peu de mon syndrome de l’imposteur… D’ailleurs je prépare un spectacle sur le thème du syndrome de l’imposteur, avec une québécoise et une suisse que j’ai rencontré durant une Pépinière d’artistes au Liban.
En effet, début octobre 2021, vous recevez la Bourse TF-CITF, Pépinière Liban 2021, grâce à laquelle vous filez au Liban pendant une dizaine de jours pour devenir « un pépin » de la CITF Commission Internationale du Théâtre Francophone. En concertation avec Hammana Artist House et l’auteure Valerie Cachard, le thème de cette édition était, « voyager léger et s’abreuver d’ailleurs ». De quoi vous-êtes-vous donc nourrie là-bas ?
Ça a été comme un très long workshop, plein de rencontres, dont celles avec Diane Albasini et Mélissa Merlot avec qui je vais monter ce projet sur le syndrome de l’imposteur. Cette pépinière est fondée sur la pluridisciplinarité, c’est l’une des conditions pour y accéder. Tous les artistes que j’ai pu y rencontrer sont pluridisciplinaires, et je me suis rendu compte à quel point c’est important de toucher un peu à tout. Les Canadiens par exemple sont très flexibles, une canadienne m’expliquait « je suis là où on a besoin de moi ». De cette dynamique a germé un projet autour d’un sujet qui concerne les femmes, dans une forme qui mêlera différentes disciplines, y compris la danse, dans une écriture au plateau. Pour l’heure, on amorce les choses.

© Luc Muller
Avec cette force cross discipline qui correspond bien aux artistes de votre génération, et après ces nombreuses plateformes d’expérimentations, résidences de recherches, voyages exploratoires, ou assistanats, quand rentrerez-vous dans le vif de la scène et son public ?
Ces dernières années, j’ai fait plein de trucs en même temps et je veux arrêter le « en même temps ». Je me suis rendu compte que je veux faire du théâtre. Je me suis prouvée que je pouvais faire de l’académique, j’y ai pris ce que j’avais à y prendre. Maintenant, je veux arrêter de bouger, rester entre Paris et Luxembourg. D’ailleurs, bientôt, je serai en résidence de recherche à l’Abbaye de Neimënster avec Diane Albasini et Mélissa Merlot pour ce projet mentionné plus haut. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus, je ne sais jamais de quel projet j’ai le droit de parler, alors je garde le mystère… Mais je me fédère, et dans ce sens, j’ai récemment créé ma compagnie : le Libeski Kollektiv. J’ai plein de projets et plein d’envies d’écriture. Il faut que j’arrête d’écrire des synopsis et que je m’y mette. Et puis, j’ai très envie d’écrire en luxembourgeois. J’aimerais que ça change de ce côté-là, que si on est luxembourgeois, qu’on puisse créer en luxembourgeois, et pourquoi pas aller ailleurs en Europe, avec un projet luxembourgeois, en luxembourgeois…
Les plus populaires
- 26 juin. 2024
- 20 juil. 2023
- 07 aoû. 2024
- 18 juil. 2024
ARTICLES
Articles
14 aoû. 2024Comment montrer l’art? 2/2
Articles
13 aoû. 2024Comment montrer l’art? 1/2
Videos
09 aoû. 2024